Coronavirus : leçons provisoires | par Alain Fabre
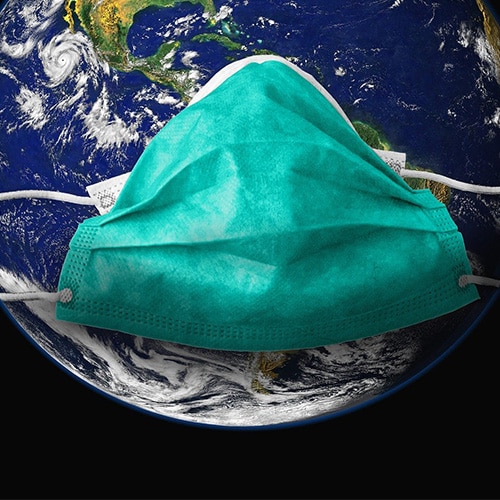
Il est toujours plus facile de prévoir le passé que le futur. Les effets de la crise du coronavirus dépendront de sa durée. Que son emprise s’étende sur un trimestre – ce qui est déjà acquis –, et l’on peut escompter une reprise graduelle d’ici l’automne 2020. Qu’elle s’étende au-delà, et une spirale récessive de grande ampleur est possible, comme une lointaine réplique de la crise de 2008.
***
Le premier impératif consiste, en évitant le double écueil de minimiser et d’exagérer la situation, à la situer dans la trajectoire des cycles de l’économie mondiale. Nous oublions trop facilement que, contrairement à ce que prophétisaient les keynésiens, les cycles existent et demeurent des composantes majeures du fonctionnement d’économies ouvertes. Les Etats-Unis ont connu onze ans de croissance, et l’Europe, neuf. Rien d’anormal donc à ce que le cycle économique se retourne après avoir duré si longtemps. Qui plus est, la nouvelle administration Trump considérant la mondialisation comme un deal perdant, a inauguré une politique de restriction des échanges vis-à-vis de l’Europe et de la Chine : ses effets dépressifs sont apparus progressivement. On peut même évoquer un process de démondialisation avec, ces dernières années, des échanges évoluant moins vite que la croissance : les signes de ralentissement aux Etats-Unis et en Allemagne, étaient visibles dès la fin 2019.
La crise du coronavirus peut s’analyser comme la percussion d’une croissance en phase de freinage – un process endogène au modèle – par un choc exogène extrêmement violent. On estime à environ 0,5/1,5 point – en fonction de sa durée – ses effets sur la croissance mondiale qui serait ainsi ramenée à 3,1% en 2020. Pour la Chine, où 30% des entreprises sont affectées, le coût de la crise est évalué à 1,1 point de PIB annuel : la croissance reviendrait à 4,5%. Les effets sur le reste du monde sont bien plus importants que le SRAS, en 2003, puisque le poids de la Chine est passé de 4 à 20% de l’économie mondiale. En Europe, l’Allemagne trois fois plus exposée à la Chine que la France, verrait passer sa croissance sous la barre de 1%. L’Italie, le pays européen le plus touché, pourrait connaitre une récession (-0,4% du PIB).
A court terme, la crise produit un double choc d’offre et de demande. Un choc d’offre avec la perturbation des chaînes de production. Exemple : SEB, tributaire de sept usines en Chine, avec un manque à gagner de 250 M€ au 1er trimestre. Parmi les secteurs les plus affectés dans leur chaine de production, il faut citer le IT : en France, la Chine représente 32% des dépenses d’investissement et 25 % des dépenses des ménages. Ou le textile : 23% de la consommation des ménages.
En ce qui concerne le choc de demande, le transport aérien est en première ligne. De nombreux groupes comme L’Oréal ou Auchan ont décrété l’interdiction des voyages. On estime à 30 Md$, les effets sur le transport aérien ; entre 150 et 200 M€ chez Air France. Le tourisme est également très déstabilisé : la France a accueilli 2 millions de Chinois en 2018 pour un montant de 4 Md€ de recettes. D’autres secteurs sont sous pression : le luxe, l’agro-alimentaire, les vins et spiritueux, la pharmacie, l’automobile,…. Des secteurs industriels qui seront aussi perturbés dans leur stratégie industrielle avec l’attentisme qui pourrait gagner les opérations de fusions & acquisitions.
***
En enclenchant une spirale de krachs en chaine, depuis le lundi noir 9 mars, les marchés ont pris le risque de transformer une crise sanitaire en crise systémique mondiale. De manière très simplifiée, leur surréaction provoque la fragmentation des circuits de financement et des économies et arme l’engrenage de la dépression : les partisans de la démondialisation pourront mesurer en accéléré ce que produit un phénomène qu’ils appellent tant de leurs vœux !
Des risques d’une telle ampleur nécessitent, non des plans de relance budgétaires nationaux tous azimuts, mais un diagnostic et une action coordonnés des grands dirigeants internationaux à des fins de stabilisation économique et financière. C’est dans ce type de contexte que prend toute son importance la fonction de réducteur d’incertitude des Etats et des banques centrales. Or, c’est là que le bât blesse, si l’on compare sommairement la situation actuelle à 2008. Alors qu’à l’époque, la plupart des Etats étaient faiblement endettés, que le bilan des banques centrales recelait des marges de manœuvre importantes pour l’activation de mesures non-conventionnelles, tel n’est plus le cas en 2020. À l’exception de l’Allemagne, la plupart des Etats européens ou les Etats-Unis, en déficit et très endettés, ont peu de moyens importants pour absorber le jeu des stabilisateurs automatiques – la non compensation des effets sur les budgets publics – : les mesures massives de soutien aux entreprises adoptées par le gouvernement sont sans doute la contrepartie inévitable de la mise à l’arrêt de l’économie pour casser la diffusion de l’épidémie, mais elles se traduiront comme en 2008, par une envolée de l’endettement public : d’ores et déjà il dépassera 100% du PIB, cette année. Côté monétaire, la Fed a réagi en baissant à deux reprises, pour les ramener à zéro, mais la BCE, quelques jours après, a fait la démonstration de son peu de moyens d’action pour avoir tiré toutes ses cartouches en période de vaches grasses. Ce qui n’a pas été sans effet sur la forte baisse des bourses dans la foulée.
Plus encore, il y avait accord sur le fond, en 2008, entre les responsables internationaux pour agir de façon conjointe : on se souvient du rôle stabilisateur des réunions du G20 initiées par la France. A l’inverse, la situation actuelle est dominée par la priorité donnée au seul intérêt national au sens le plus restreint du terme. A preuve, l’échec des discussions entre la Russie et l’Arabie saoudite, le 8 mars, qui a provoqué l’écroulement du marché pétrolier le lendemain ; ou bien la décision de l’Administration Trump, le 12 mars, de fermer le territoire américain aux Européens. Des décisions non coordonnées visant principalement renvoyer la crise chez les autres au risque de l’amplifier au lieu de la maitriser. Là où Obama, Merkel, Brown et Sarkozy pouvaient s’accorder, rien probablement de semblable entre Trump, Johnson, Macron et Merkel. En outre, avec un couple franco-allemand bien moins soudé qu’il y a douze ans, l’Europe risque par sa faiblesse et ses divisions d’accentuer les effets des chocs sur son économie, comme l’illustre le cavalier seul de chaque Etat dans le contrôle des frontières.
***
Au-delà du court terme et de la récession probablement inévitable au 1er trimestre, la leçon – provisoire – des quelques semaines de crise est double. La première concerne la conduite des politiques économiques : depuis plus de 30 ans, les Etats et les banques centrales ont fait le choix de politiques accommodantes en permanence. Leur activisme censé amortir les cycles bas ne cesse pas quand le cycle repart à la hausse. On l’a vu avec la BCE qui, en 2015, a activé des mesures quantitatives en phase de croissance. Or, l’expérience montre que l’endettement des Etats et des banques centrales ne consomme pas seulement des marges de manœuvre qui font défaut en période de vaches maigres, mais amplifie les cycles. Avec au passage, des effets collatéraux comme la déstabilisation des économies par un excès de financiarisation ou le creusement des inégalités à la faveur de rentes allouées par les Etats aux opérateurs des marchés.
L’autre conséquence, de long terme, c’est l’accentuation d’une tendance à l’œuvre depuis 2016 : la révision sur un mode réaliste de la relation des Occidentaux avec la Chine tant au niveau politique – une exigence plus affirmée de réciprocité – qu’au regard de la dépendance excessive des entreprises à un pays prétendant au leadership économique mondial tout en fonctionnant comme une dictature du tiers-monde. De ce point de vue, en Europe, la prise de contrôle de Kuka, un des fleurons industriels allemands, par Medea, très proche du PC chinois, en 2016, aux Etats-Unis, la révision musclée des relations commerciales imposée par l’Administration Trump, depuis 2017, ont constitué autant de signaux d’une prise de conscience progressive, que la coronavirus va nécessairement accentuer.
C’est dire si la Chine joue gros dans cette crise. Car, l’ajustement de la relation peut se lire aussi comme une nécessité en relation avec le changement de cap du pouvoir chinois depuis la désignation à sa tête, en novembre 2012, de Xi Jinping, renouant, en vertu d’un « mandat du ciel », avec une ligne maoïste. Le coronavirus illustre bien les risques de l’accentuation autoritaire du pouvoir qui donne la priorité, non à la lutte contre les épidémies, mais au contrôle social de la population, comme en fournit un exemple probant, le banquet de 40.000 personnes organisé à Wuhan, le 18 janvier alors que le mal était connu depuis décembre. La façon dont le nouvel empereur rouge sortira son pays de la crise du coronavirus peut avoir des conséquences décisives au sein même du PC chinois, dans la rivalité qui depuis 45 ans, oppose ceux qui défendent une ligne Mao autoritaire à ceux qui suivent une ligne réformiste Deng. Les crises, rappelait Lénine, sont des accélérateurs de l’histoire : en Chine comme en Occident, il y aura un avant et un après-coronavirus.
Alain Fabre
Directeur Associé
In Extenso Finance & Transmission